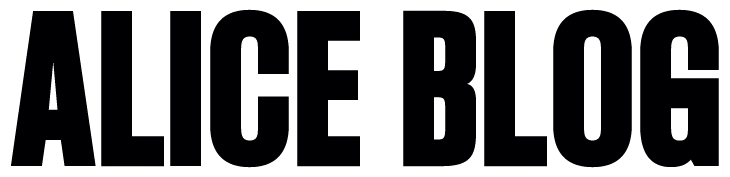Inversant le rapport spirituel que Dante en avait imaginé, Pier Paolo Pasolini repense, au siècle dernier, l’image des petites lumières (lucciole) en rapport à la grande et unique lumière (luce) pour illustrer les rapports de pouvoirs de l’histoire moderne: entre les puissantes lumières du pouvoir et les lueurs survivantes des contre-pouvoirs, qui errent dans l’obscurité, telles des lucioles. S’il se désole de leurs disparitions, Georges Didi-Huberman, lui, soutient aujourd’hui dans son livre Survivance des lucioles que les lucioles « ne disparaissent qu’à la vue de ceux qui ne sont plus à la bonne place pour les voir émettre leurs signaux lumineux », éblouis qu’ils sont sûrement par le grand faisceau auquel ils sont soumis.
Les lucioles, en période de reproduction, émettent ce signal lumineux qui leur est caractéristique permettant aux partenaires de la même espèce de les reconnaître et de les retrouver. Lorsque leur faible luminance est exposée au « féroces projecteurs » de nos éclairages artificiels, les lucioles n’ont d’autres choix que de fuir vers un ailleurs en dehors de la zone de luminance de ces faisceaux lumineux, ou du moins à sa limite (quoique quelques comportements suicidaires ont également pu être observés).
Lorsque l’on est soumis à l’unique puissante lumière, il y a tout lieu de croire à la disparition des lucioles; elles ne sont plus visibles. Pourtant elles survivent encore et il suffit de se déplacer, de s’éloigner de l’influence des projecteurs et d’ouvrir les yeux dans l’obscurité pour avoir une chance de les apercevoir.