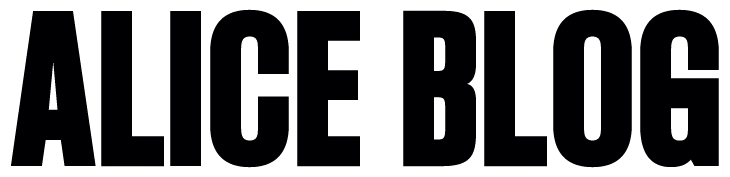Dans le cadre de la phase Measures, notre étude s’est portée sur un élément de l’éclairage urbain, le lampadaire. Cet attribut de nos villes qui passe souvent inaperçu de jour est néanmoins essentiel de nuit. En effet, il est écrit dans les archives de l’Académie française : “L’apologue du lampadaire est paraît-il bien connu des chercheurs : un type qui a perdu ses clés explore en vain les dessous d’un lampadaire en pleine nuit. Pourquoi chercher seulement là? Parce que c’est le seul endroit éclairé.” L’étymologie du mot “lampadaire” appuie cet état de fait, puisqu’elle fait référence aux lampades, des nymphes issues de la mythologie grecque, qui éclaireraient le chemin de la déesse Hécate dans les profondeurs des enfers.
Dans une dimension plus technique, le lampadaire assure trois fonctions : il garantit la sécurité des biens et des personnes, facilite une activité nocturne et participe à la valorisation du patrimoine bâti. Il se compose d’un mât, d’une lanterne d’éclairage et d’une console autonome, centralisée ou intelligente. Les variations de forme de la lanterne d’éclairage régissent la direction de diffusion de la lumière. Deux types d’ampoules sont utilisés, les ampoules à incandescence qui présentent une intensité lumineuse avoisinant les 80 lumen/watt et plus récemment les LED avec un flux lumineux sept fois plus important.
A l’issue de nos recherches, nous sommes retournées sur Genève afin de répertorier précisément les différents types de lampadaires et leur emplacement dans l’intention de dresser l’inventaire de cet élément urbain. Nous avons pu observer que l’ensemble des réverbères du secteur des feuillantines s’allumaient à 19h et ainsi déterminer que ces derniers étaient alimentés de manière centralisée. A la suite de cela, nous avons établi le portrait de quatre lampadaires :
> le lampadaire de mise en valeur du patrimoine, situé dans le parc de l’Ariana. Haut d’environ 5 mètres, son faisceau lumineux est dirigé vers le musée de l’Ariana. L’intensité lumineuse importante permise par l’ampoule LED donne l’impression que le musée se découpe dans la nuit noire.
> le lampadaire permettant l’éclairage de la voie piétonne, situé dans le quartier résidentiel. Sa hauteur avoisinant les 3 mètres permet de limiter la diffusion de l’éclairage à la zone réservée aux piétons. Il n’y a que peu de pertes lumineuses afin de réduire l’impact de l’éclairage sur les bâtiments avoisinants.
> le lampadaire permettant l’éclairage routier, situé le long des axes de transport. Culminant à 20 mètres de hauteur, sa fixation latérale permet de concentrer le faisceau lumineux sur la voie empruntée par les automobilistes. L’orientation contrainte de l’éclairage entraîne la création de zones d’ombres, notamment le long des voies piétonnes, révélatrice de la volonté de la ville de favoriser le transport en voiture dans ce secteur plutôt que le déplacement piéton. Le passage des ampoules à incandescence aux ampoules LED le long de la route de Ferney met en exergue la volonté de la ville de s’inscrire dans une politique plus respectueuse de l’environnement à la suite de nombreuses villes. On peut estimer la date de ce changement entre octobre 2014 et aujourd’hui en comparant les données Google Maps et les relevés actuels du territoire. L’utilisation de LED reste néanmoins un choix très controversé.
En effet, la ville de Genève semble s’engager dans la protection de la faune et la flore nocturne en établissant une “trame noire” dans le cadre du Plan lumière II, c’est-à-dire en définissant des zones où l’obscurité peut être préservée et ainsi offrir un réseau de vie pour toutes les espèces sensibles à la lumière peuplant ce territoire telles que les pipistrelles, les hiboux de marais, les hérissons, les fouines, les papillons de nuit… Néanmoins, ce changement répondrait plus à un effet de mode qui pousse les villes à changer une grande partie des éclairages urbains en LED car connotées plus écologiques et économiques. L’architecte éclairagiste genevoise Florence Colace sent presque que l’on veut lui forcer la main, estime-t-elle dans un article datant de janvier 2015. Ainsi, le passage aux LED dans le cadre de la biodiversité est sujet à caution lorsque l’on sait que l’intensité lumineuse des LED est bien plus importante que celle des lampes à incandescence. L’oeil humain voit mieux dans le jaune et le vert (555 nanomètres) car cette longueur d’onde nécessite une faible intensité lumineuse pour passer dans le spectre visible. Même si elles émettent une lumière blanche, les LED utilisées ont une dominante de bleue, la longueur d’onde la plus agressive pour la cornée : LED bleues revêtues d’un phosphore jaune qui convertit les rayons bleus en blancs. De ce fait, la volonté de l’être humain de créer une continuité entre le jour et la nuit se fait au dépend de la biodiversité nocturne. L’autre écueil est lié à la forte luminance. En effet, les sources LED se caractérisent par un éclairage très directif où la lumière est jusqu’à 1 000 fois plus concentrée que dans les systèmes d’éclairage classiques. On peut alors se demander qu’en est-il des animaux nocturnes pour qui leur rétine est bien plus sensible à la lumière ?
En définitive, si l’éclairage urbain reste l’une des conditions majeures de la vie nocturne, il s’agirait avant tout de considérer maintenant la nuit comme un espace à préserver que comme un espace à conquérir.