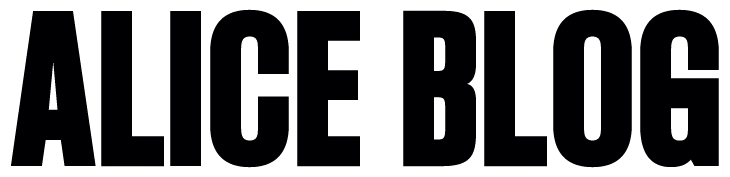0.Introduction.
« Ainsi la matière dont se nourrit le sujet parlant pour se produire, se reproduire ; la scénographie qui rend praticable la représentation telle qu’elle se définit en philosophie, c’est-à-dire l’architectonique de son théâtre, son cadrage de l’espace-temps, son économie géométrique, son ameublement, ses acteurs, leurs positions respectives, leurs dialogues, voire leurs rapports tragiques, sans oublier le miroir, le plus souvent masqué, qui permet au logos, au sujet, de se redoubler, de se réfléchir, lui-même. » P. 39
Luce Irigaray, « Pouvoir du discours, subordination du féminin », Ce sexe qui n’en est pas un.
Cet énoncé a pour but de comprendre le rôle de l’espace dans la construction sociale du genre ou, pour reprendre une définition donnée par Christopher Wilson, comment la matérialité et les décisions matérielles affectent la construction de l’architecture, mais aussi les constructions de l’architecture, sous-entendant ainsi les constructions sociales générées par elle. L’analogie entre architecture et genre portée par le mot construction est amenée par le mode de pensée constructiviste du champ des gender studies, qui promeut l’idée du genre comme n’étant absolument pas inné mais au contraire plutôt construit par notre société. Le mode de pensée constructiviste a été mis sur le devant de la scène par Simone de Beauvoir et son essai Le Deuxième Sexe, dans lequel elle énonce cette phrase devenue célèbre depuis : on ne naît pas femme, on le devient, mais la notion constructiviste qui va réellement nous occuper dans cet essai est celle de performativité, introduite par Judith Butler dans son désormais célèbre Gender Trouble.
Gender Trouble, traduit un peu tardivement en français par Trouble dans le genre, est devenu l’un des textes fondateurs de la théorie du genre ainsi que de la théorie queer. Butler avance la théorie de la performativité, selon laquelle le genre est performance et performativité. Dans cette idée-là, le genre est construit par une série de performances répétitives qu’on effectue en fonction du sexe qui nous a été assigné à la naissance. L’aspect perfomatif du genre serait révélé par le drag, le travestissement, comme nous l’explique Sam Boursier dans Queer Zones. « Butler propose une interprétation radicale du travestissement, qui serait cette possibilité d’imitation-répétition infidèle des normes en imitant le genre en lui-même : « en imitant le genre, le travestissement révèle implicitement la structure imitative du genre en lui-même, de même que sa contingence. » La possibilité même du travestissement constituerait la preuve que le genre n’est que fiction et performance au sens théâtral et linguistique du terme. » L’idée peut finalement être résumée en une seule phrase : all genders are drag. Les modèles féminins et masculins hétéronormés n’existent donc pas en réalité. La féminité ne consiste donc qu’en une série de performances de ce qu’on considère socialement être la féminité : « de tels actes, de tels gestes, de tels décrets généralement construits sont performatifs, en ce sens que l’essence ou l’identité qu’ils prétendent exprimer sont des inventions fabriquées et maintenues grâce à des signes corporels et à d’autres moyens discursifs. Dire que le corps genré est performatifs revient à dire qu’il n’y a pas de statut ontologique du genre mis à part les actes divers qui constituent sa réalité. »
Le concept de performativité a également été employé pour analyser l’espace et ses articulations de pouvoir. Dans Taking Butler Elsewhere, Nicky Gregson, Gillian Rose expliquent que nombres de géographes estiment en effet que l’espace est créé par le biais de performances, et que la performativité est un outils conceptuel important pouvant dénaturaliser des pratiques sociales considérées comme évidentes, tout en mettant en évidence la créativité de la vie quotidienne. Les concepts de performance et performativité sont aussi employés par Katarina Bonneviers dans son analyse d’espaces domestiques queer dans Behind Straight Curtains : “In any building activity ideologies and norms are reiterated. What I want to bring into play is that this also works the other way around – subject positions are partly constructed through building activities. Feminist and queer perspectives, especially theories of performance, performativity and heteronormativity, are critical stands throughout the thesis to investigate how this happens. Enactment is the key term I propose for the study of this entanglement of actors, acts and architecture. It holds an overtly theatrical association along with a performative force.”
La femme, ou plutôt les personnes assignées femme à la naissance, ont été cantonnées dans la sphère domestique pendant les derniers siècles. Les femmes ont donc toujours été considérées comme des créatures domestiques, dont le milieu naturel est le home. L’espace domestique est donc la scène principale de la performativité féminine, ce qui en fait donc le lieu d’étude idéal de la construction sociale de la femme à travers l’architecture. Cet énoncé va donc se concentrer sur l’étude de la performativité de l’espace domestique. Le but de ce travail est d’œuvrer dans l’optique d’une dé-construction du genre à travers la dé-construction de son environnement bâti. L’idée est de décortiquer l’espace domestique performatif en ses composantes afin d’en comprendre l’essence, raison pour laquelle j’ai choisi d’étudier le potentiel performatif des éléments architecturaux qui génèrent l’espace habité. Les éléments ont traditionnellement été employés afin de renforcer la ségrégation des genres et cantonner les individus dans des rôles genrés hétéronormée et pré-déterminés, mais certains architectes ont au contraire imaginé des éléments subversifs, conçus pour des espaces queer rejetant l’(hétéro)normativité.
La première définition du concept de performativité, d’abord énoncée par Austin dans le cadre de sa speech act theory avant d’être repris par Butler, permet de définir les caractéristiques de l’élément performatif. La performativité se définit ainsi: « if a word might be said to `do’ a thing, then it appears that the word not only signifies a thing, but that this signification will also be an enactment of the thing. It seems here that the meaning of a performative act is to be found in this apparent coincidence of signifying and enacting ». L’élément performatif se définit de la même façon que le mot. Une porte a une fonction – relier deux espaces – mais elle joue également un rôle social de reconnexion et d’interaction comme le présente par exemple Evans. Cette signification-là est activée à travers une enacment. La porte est donc un élément performatif.
La répétition est essentielle à la construction de la norme et à la performativité. Comme le dit Judith Butler, citée par Katarina Bonnevier “norm acquires its durability through being reinstated time and again. Thus, a norm does not have to be static in order to last; in fact, it cannot be static if it is to last.” La répétition n’est donc jamais exacte. C’est justement dans cette inexactitude de la répétition que se trouve une certaine puissance d’agir (agency) et de disruption de l’(hétéro)normativité. Ces remarques s’appliquent aux éléments performatifs. La porte en est à nouveau un excellent exemple ; on ouvre et ferme des portes, qui ont d’ailleurs toutes plus ou moins les mêmes dimensions standardisées, des dizaines de fois par jour. Mais bien que toutes ces portes semblent être identiques, elles ne sont en fait que similaires. C’est dans cette inexactitude de la répétition que se situe le potentiel subversif de l’élément architectural performatif.
La performativité de l’élément est donc établie à travers une analogie entre architecture et discours, entre élément et mot. Le terme scénographie – en titre de cet énoncé – porte également une signification liée à la pratique du discours qui est souvent chassée par sa signification plus matérielle et théâtrale. Il fait partie, dans l’étude du discours, du concept plus large de scène d’énonciation, qui « met l’accent sur le fait que l’énonciation advient dans un espace institué, défini par un discours, mais aussi sur la dimension constructive de ce discours, qui instaure son propre espace d’énonciation ». La scène d’énonciation serait constituée de trois scènes interconnectées : la scène englobante, la scène générique et enfin, la scénographie. Contrairement aux deux premières scènes qui ont plutôt une fonction descriptive du contexte et support dans lequel le discours s’inscrit, la scénographie induit une relation plus complexe entre les acteurs et leur scène, où elle ne s’impose pas par le genre ou type du discours, mais est plutôt créée par le discours même. Un discours impose donc sa scénographie, que son énonciation s’efforce simultanément de justifier, ce qui induit un processus en boucle : en émergeant, la parole implique une certaine scène d’énonciation, laquelle se valide et se légitime progressivement à travers cette énonciation même. La scénographie est ainsi le produit du discours ainsi que ce qui l’engendre.
Cette définition de scénographie prête au protagoniste une certaine puissance d’agir (agency) sur son propre discours. Si on quitte le contexte du discours pour retourner dans le contexte architectural, c’est une notion qui me paraît essentielle à la compréhension de l’espace performatif et de la possibilité qu’il laisse à une certaine subversivité. Comme le souligne Robin Evans à la fin de son essai Figures, Doors, Passages, il ne serait pas juste de prétendre que l’individu est complètement influencé par l’environnement architectural dans lequel il évolue, mais il serait tout aussi faux de prétendre que l’architecture n’a aucune influence sur le comportement social d’un individu. L’espace domestique et l’individu genré sont deux entités interconnectées qui se produisent et justifient l’un l’autre dans le même processus en boucle que la scénographie de la scène d’énonciation et le discours. Cela signifie aussi qu’un espace queer pourrait exercer une influence subversive dans la construction sociale de l’individu qui y évolue.
Une analogie entre élément et mot déjà proposée par Christopher Alexander dans son chapitre introductif The Poetry of Language dans A Pattern Language, dans lequel il encourage les architectes à concevoir leurs espaces de la même manière qu’un auteur.ice écrit de la poésie, c’est-à-dire en jouant sur la signification et la superposition des mots. La différence entre la prose et la poésie ne tient en effet pas dans une différence de langage mais plutôt dans la manière dont le langage est utilisé. Les patterns forment un langage qui devient plus riche et poétique lorsqu’ils sont compressés et superposés, créant une densité et une profondeur. Tout comme le mot, le pattern, ou l’élément, est influencé par la signification de celui qui se trouve à côté de lui, ils sont donc interconnectés. La performativité des éléments est fortement influencée par les éléments qui se trouvent dans le même espace. Bien que l’atlas proposé par cet énoncé abstraie des éléments hors de leur contexte pour les analyser, le texte sous forme de paragraphe est toujours là pour repositionner la scène de référence de laquelle ils sont extraits. Tout comme Alexander le fait dans son A Pattern Language, où il s’applique à proposer des solutions aux problèmes énoncés par le pattern, cet énoncé analyse et met en évidence la performativité des éléments qui composent la scénographie dans laquelle le genre est construit et produit afin de pouvoir ensuite en abstraire un langage subversif.
{Insérer un paragraphe sur la positionalité, en lien avec Giving an Account of Oneself de Judith Butler, le Postscript de Katarina Bonnevier et Architecture and Text de Jennifer Bloomer.}
{Insérer quelques précisions sur la différence entre performativité et performance basées sur les textes The Presentation of Self in Everyday Life de Erving Goffman, Performativity and Performance de Andrew Parker et Eve Kosofsky Sedwick, Taking Butler Elsewhere de Nicky Gregson et Gillian Rose et Bodies that Matter de Judith Butler.}