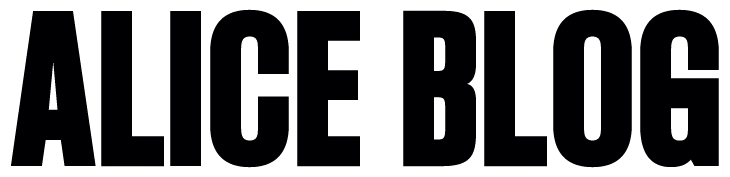Née en 1985 à Port-au-Prince, où elle vit et travaille, Tessa Mars est une plasticienne de la nouvelle génération haïtienne. Arrière-petite-fille de l’ethnologue et écrivain Jean Price Mars, elle est issue d’une lignée d’intellectuels et d’artistes engagés. Formée en arts plastiques à l’université de Rennes 2, en France, elle obtient son diplôme en 2006. De retour en Haïti, elle collabore avec la Fondation AfricAmerica dans la mise en place de projets culturels aux côtés des artistes Maksaens Denis et Barbara Prézeau Stephenson. La carrière artistique de Tessa Mars commence véritablement en 2008 avec sa participation au 5e Forum Transculturel d’art Contemporain de Port-au-Prince organisé par AfricAmerica. Suit une exposition en duo avec le sculpteur Eddy Rémy au musée Georges Liautaud de Croix des Bouquets (2009) et l’exposition collective, Haïti, Royaume de ce monde (2011). Cette exposition itinérante présentée initialement à la galerie Agnès b. à Paris inaugure le premier pavillon haïtien à la Biennale de Venise la même année.

Pourrais tu introduire et décrire un peu travail? Est ce que tu considères tes peintures comme sophistiquées, ou y a-t-il une attache à une forme plus populaire, ou naïf ?
Je ne cherche pas moi-même à me situer dans une catégorie de peinture. Je peins des gens, et encore plus spécifiquement je fais un travail sur moi-même, sur la « self-representation ». J’ai fait mes études en France, j’ai étudié les Arts Plastiques et ça a laissé des traces dans ma façon de travailler, de concevoir, qui est peut être différent de certains artistes qui ne sont pas issu d’un parcours. Mais l’influence des artistes haïtiens que j’aime, et avec lesquels j’ai grandi, est quand même assez forte. Je suis connu principalement pour la création de ce personnage, l’alter-égo de moi-même, que j’ai appelé « Tessalines ». Elle est quand même emblématique de toute ma pratique artistique, parce que ce qui m’intéresse principalement c’est l’Histoire, plus précisément comment l’identité haïtienne se construit au travers de l’histoire, les traditions, et comment celles ci sont perçues aujourd’hui, comment elles sont transmises, et qu’est ce que ça représente. Tessalines est un clin d’œil à Dessalines, le père fondateur de l’histoire d’Haïti. C’est aussi un moyen de questionner le rôle de femmes dans l’histoire d’Haïti, car on n’en entend pas beaucoup parler. Mais surtout c’est un moyen de m’attacher moi même à cette histoire, de m’inscrire dedans. Comment je m’identifie, comment je me l’approprie. Quel sens je vais donner à cette histoire qui puisse me permettre de faire face à ce que je vis au quotidien et de comprendre la réalité haïtienne qui est parfois tellement tragique et de comprendre aussi pourquoi on est dans cette situation. Mon travail je le qualifierais de « décolonial », parce que c’est le cadre de penser qui m’attire le plus et qui fait le plus sens lorsqu’il s’agit de comprendre les mécanismes qui régissent les relations entre Haïti et les autres pays de la Caraïbes, entre Haïti et les autres pays Occidentaux. L’influence des peintres haïtiens est plutôt de l’ordre de l’histoire. Je dois dire aussi que je n’aime pas trop le terme de « magical realism », mais pour moi il y a toujours un aspect de l’étrange et du mystérieux dans mon travail qui est très important pour moi, parce qu’il s’agit de traduire cette réalité là. L’imaginaire haïtien c’est ce quotidien des gens qui voient cette magie partout. « magical realism » suggère que magie et réalité sont deux choses différentes, pour moi c’est vraiment la même chose. J’essaye de traduire cette vision là dans mon travail, qui signifie l’attachement que les haïtiens ont par exemple avec la nature, les ancêtres et les esprits. C’est quelque chose de culturel, folklorique, et ce sont des éléments clés. Je ne pense pas seulement mon travail en terme de peinture, mais aussi en terme d’installation. Je suis par exemple actuellement en train d’explorer une technique traditionnelle en Haïti qui est la papier mâché, qui est souvent associé au carnaval et à une dimension artisanale. C’est-à-dire que les artistes contemporains jusqu’à présent n’explorent pas cette technique là, ils font plutôt de la céramique, du bois… J’explore aussi la vidéo. Dans ma pratique la peinture est importante, parce que mon processus passe par la conception d’image 2d, donc peinture, mais ensuite ça se développe en décor, en tout un univers.

- Tu ne considères donc pas ta pratique de « naïve » ?
Je ne m’identifie à aucun de ces courants naïfs, parce que le mot « naïf » n’a pas toujours été présent, il intervient dans une situation bien particulière, après la visite d’André Malraux, qui va observer les artistes haïtiens et qui instaure cette idée du « naïf ». Mais il vient avec sa théorie déjà toute faite, il a vu ce qu’il voulait voir. Cela a créé une explosion dans la création artistique haïtienne, il y aura une grande demande qui va aider les artistes mais qui va aussi les mettre dans une position ou ils vont se faire lésés et exploités, mais également coincés sous ce qualificatif. Trop souvent après l’étiquette de « naïf », la réflexion s’arrête là. Je ne fais pas du « naïf » aussi parce qu’à partir du moment ou on fait des études, on a tendance à mettre de côté ce mot. C’est aussi une façon de caser les gens, ça véhicule l’idée de l’haïtien sans éducation qui fait une peinture bêbête, surdouée, mais un peu égarée, et c’est problématique. Cette idée « d’Ecole » fait que les gens deviennent attachés par ce que ça représente. Certaines personnes en Haïti s’attachent à des Ecoles traditionnelles comme le cubisme, ou alors certains créent leurs propres mouvements. « L’Ecole de la beauté » par exemple. Mais je n’ai personnellement pas d’intérêt à me situer dans aucun de ces mouvements. Ma peinture c’est d’abord des portraits.

- Comment ton travail se passe en Haïti ? Dans quelles galeries as tu exposé ?
Je suis rentré en Haïti en 2006. De 2006 à l’année passée j’ai vécu en Haïti. Depuis quinze ans ma carrière est en Haïti, avec quelques périodes de production à l’étranger. C’est là que j’ai développé ma pratique et mon réseau initial. Lorsque je suis rentré en 2006, je n’ai pas vraiment produit pendant les trois premières années. Je ne savais pas de quoi je voulais parler dans mon travail. C’était plutôt une période d’observation du milieu, de rencontrer les artistes et de savoir ce qu’il se faisait. J’ai visité des espaces qu’il y avait à l’époque. La fondation AfricAméricA, dirigée par Barbara Prézeau-Stephenson, organisait tous les deux ans un forum d’art contemporain qui invitait des artistes du continent Africains, des caraïbes et aussi des Amériques.

Pendant deux semaines ces artistes venaient produire en collaboration avec les artistes haïtiens. C’est comme ça que j’ai rencontré plusieurs personnes importantes qui m’ont permis de me construire en tant qu’artiste. Haïti m’a vraiment été bénéfique. Ca n’est pas toujours le cas pour tout le monde, mais j’ai eu une place très privilégiée. J’ai un atelier chez moi, un espace de travail, ça aussi c’est déjà un privilège, je n’ai pas de loyer à payer. En Haïti je suis quand même d’un milieu assez privilégié, donc je n’ai pas cette contrainte du quotidien. Je peux me permettre de ne pas vendre, et de ne pas faire d’exposition pendant une période assez longue. Ca m’a permis de développer un bagage qui m’étais propre et de faire le choix d’ou j’expose, quand, comment et avec qui. Je n’ai jamais exposé en Haïti avec une galerie commerciale. J’ai exposé avec la fondation AfricAméricA une fois, ma première exposition en 2009 avec un sculpteur. J’ai ensuite eu d’autres événements comme ça, jusqu’à ma première exposition individuelle, qui a lieu l’année passée en 2019 au Centre D’Art. Cette institution est également très importante pour moi dans ma carrière, non seulement parce que mon exposition était grande, et a réuni beaucoup de mon travail, mais aussi parce qu’il y a eu la production de catalogues. Ca c’est quelque chose de pas courant en Haïti, qu’une institution locale tienne à ce qu’il y ait la production de catalogue, donc de réflexions, qui accompagne le travail de l’artiste. C’est quelque chose qui reste, ce sont des traces de mon travail. Je me suis connecté au Centre D’Art en 2014-2015, car il s’est reconstruit après le tremblement de terre de 2010. Ils ont re-déterminé leurs nouvelles directives et impératifs et ils se sont rapprochés des jeunes créateurs, dans l’objectif de les aider à développer leurs carrières. Je suis rentré au Centre D’Art en tant que professeur d’abord, je donnais donc des ateliers ouverts à tout public. Ce n’étaient pas des cours spécialisés pour des étudiants en Art. C’est comme ça que j’ai développé un lien avec le Centre d’Art. Ce que j’aime dans cette institution c’est le fait de donner des opportunités, et à moindre coût. Quand ils peuvent ils donnent des bourses, ils font venir des opportunités, pour les jeunes en particulier et osent aussi appuyer la production de ceux qui sont sur le terrain depuis longtemps mais qui n’ont pas eu de reconnaissance. Egalement pour les artistes décédés, parce qu’ils ont une certaine collection qu’ils cherchent à valoriser.
- Mise à part le Centre D’Art y a-t-il d’autres infrastructures qui promeuvent la création artistique, notamment des jeunes artistes ?
Avec la fondation AfricAméricA, il y a aussi une fondation qui s’appelle « Culture Création ». Ce ne sont pas des fondations qui ont les moyens d’avoir un programme permanent, ni de soutenir comme le fait le Centre D’Art. Elles se concentrent souvent sur une activité, comme le forum qui s’organise tous les deux ans dont je te parlais, ou quand il y a l’opportunité particulière de réaliser un projet. Mais ce ne sont pas des espaces ou l’on peut rentrer comme ça et découvrir. Pourtant même sans avoir les moyens ils continuent de fournir un réseau, en rassemblant des artistes africains et haïtiens par exemple. Mon impression c’est que « Culture et Création » est un peu plus traditionnel, je pense que les gens qui en sont à la tête étaient eux mêmes à la tête de galeries commerciales. Donc des gens déjà établis avec une certaine façon de faire en collaboration avec des artistes qu’ils connaissent depuis longtemps, et qu’ils savent qu’ils font vendre.

J’ai toujours associé cette fondation avec quelque chose de beaucoup plus traditionnel ou classique qui se faisait et qui continue de se faire. Par exemple les artistes de la Grand Rue, qui sont des sculpteurs faisant de la récupération, sont devenus maintenant carrément « mainstream ». C’est-à-dire que lorsqu’ils ont commencé ils sont passés par la fondation AfricAméricA. Maintenant qu’ils sont établis, tout le monde en redemande. De manière plus globale il y a l’organisation « fokal », qui n’est pas une organisation qui œuvre seulement dans l’art visuel, mais aussi dans le théâtre, littérature, la culture en général. Ils existent depuis longtemps, et sont en partenariat avec une grande société américaine. C’est une structure stable et rigoureuse. C’est l’une des structures qui oeuvrent dans la culture les plus solides et pérennes.

- Tu ne juges donc pas forcément qu’il y ait un manque d’infrastructures ?
Si pour moi il y a Fokal et le Centre D’Art, comme les seules structures qui vraiment fonctionnent, ça en fait deux à Port-au-Prince. Il y a des petites structures que les artistes eux-mêmes créent mais qui ne marchent pas vraiment. Si on regarde à la base, il n’y a par exemple pas une seule école valable et qui fonctionne. Le Centre D’Art n’est pas une école, ils ont des cours temporaires sur trois mois et qui se renouvellent, mais ce n’est pas un cursus qui te donne un diplôme, qui poursuit une réflexion. Si tu suis tout ce qu’offre le Centre D’Art tu vas développer tes connaissances techniques certainement, mais tu ne suivras pas une réflexion sur l’Art. C’est important évidemment, mais ça devrait venir en complément de quelque chose beaucoup plus structuré et réfléchi. L’Ecole National des Arts, depuis que je suis rentré en Haïti je trouvais que c’était un espace problématique. Depuis plusieurs années maintenant elle ne fonctionne pratiquement pas. Et le niveau d’éducation qui est fourni est questionnable. Cela fait qu’il n’y a pas d’école d’art en Haïti. La plupart des artistes qui travaillent maintenant sont autodidactes ou alors ont fait des études à l’étranger. Au fait, beaucoup d’artistes haïtiens contemporains vivent dans la diaspora.
On parle là des institutions, mais la pratique de la peinture informelle est beaucoup plus présente en Haïti, comme les peintres de rue ou les détournements d’espaces. Est ce que tu as des exemples et est ce que tu as dû passer par là ?
Parce que justement il n’y a pas ces espaces ou structures, les artistes se mettent en collectifs pour essayer de faire des « happenings ». Il y a cet événement assez régulier qui s’appelle « Nou Pran Lari a » (« Nous prenons la rue »), ou certains artistes occupent l’espace public pendant 24h ou plus pour montrer leurs travaux de sculpture, de peinture.

Il y a également cette utilisation d’espaces qui ne sont pas dédiés à ça. Là ça va être quelque chose de donnant-donnant, car c’est une façon pour les propriétaires d’attirer un public. Il y a cet espace d’Hôtel-restaurant, La Lorraine, à Pétion-Ville, qui est l’un des espaces les plus huppés qui proposent ce genre d’arrangement et eux ne demande rien en retour. Celui là est très huppé mais les artistes cherchent à exploiter tous les espaces disponibles, donc souvent des restaurants, parfois des boites de nuit… Investir la rue, c’est le mode de fonctionnement de l’activité elle même, comme par exemple les artistes de la Croix-Des-Bouquets. Ils font exclusivement du fer forgé, et ça a transformé énormément la nature de cet espace là. Ce sont des ateliers à ciel ouvert, et ça a donné lieu à un projet d’urbanisation autour du village. C’était un projet culturel phare afin de valoriser le village, refaire les infrastructures, embellir et rendre plus attrayant pour les visiteurs, et faciliter la vie des locaux. J’ai été assez active dans le village car on m’avait proposé de réaliser un travail mural intérieur dans un temple vaudou.
- A quel point cette pratique de rue est-elle mercantile ?
Les artistes pratiquant de manière informelle cherchent à attirer le regard, et ciblent d’abord les touristes car peu d’haïtiens locaux achètent ces toiles à priori. Ils visent en priorité les gens de passage. Il y avait suffisamment de touristes à une époque pour faire tourner ce marché là. C’est une production artisanale. Donc ils existent mais ils souffrent. Ils souffrent encore plus des crises politiques qu’il y a depuis ces dernières années. Et les choses ne vont pas beaucoup mieux. Ce n’est pas un terrain qui est documenté. Les traces de cet art se trouvent sur les cartes postales, et fait partie du décor. Ca dit quelque chose sur tout le domaine artisanal en général. Naturellement qu’il y a des choses intéressantes qui s’y passent, il y a aussi des artistes qui produisent mais il y en a qui reproduisent des travaux d’artistes à succès. Il y a donc un dialogue qui se passe, mais aussi une forme d’humour qui se trouve peut être dans la dégradation ou la différence de « skills ». Mais je ne sais pas dans quelle mesure les gens en vivent vraiment et souvent il y a du désespoir dans ce métier là. Ils vendent souvent pour pas grand chose.
Même pour ça il y aurait besoin d’un support, d’une institution parce que même lorsqu’on pourrait dire qu’ils font de l’édulcoré, ça reste une richesse et quelque chose qui est spécifique au pays.
Je compare à la République Dominicaine : Au cœur de la ville il y a ce passage piéton ou des deux côtés de la rue il y a des boutiques et au murs il y a des toiles. Souvent ce sont des artistes haïtiens, des jeunes qui réussissent à passer la frontière : c’est évident qu’ils bénéficient d’un support de l’Etat. Le fait même qu’il y ait cet espace ou les gens viennent véritablement c’est un avantage dont ne bénéficient pas les artistes en Haïti. Un autre endroit de l’artisanat à Port-au-Prince c’était le Marché de Fer. Une partie a brûlé mais il se trouve dans une zone assez dangereuse. Donc qui y va…