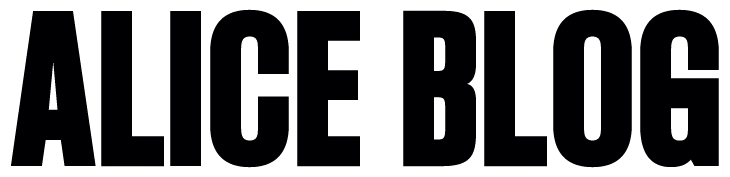Cet article fait référence à deux articles antérieurs, « Protofigures dans l’Histoire« et « Centuriation romaine : une division géométrique du territoire«
Selon le dictionnaire CNRTL, le carroyage est :
♦ CARTOGR., TOPOGR. Ensemble des lignes qui divisent une surface en carrés. Synon. quadrillage.
♦ DESSIN. Action de tracer un quadrillage sur un dessin pour le reproduire.
.♦ MILIT. (TECHN.). Action de diviser un territoire en carrés afin d’en prendre méthodiquement le contrôle :
Le carroyage, se réfère directement aux centuriation romaines (voir « Centuriation romaines : une division géométrique du territoire »). Il est donc un rapport au territoire par un élément, le carré. Le CODEX nous dit que » *l’élément* devient le point de départ de la composition (…), ce qui compte alors, c’est son potentiel d’association avec d’autres éléments pour former un tout ».
Ce tout serait le quadrillage, qui à l’image de son utilisation dans la centuriation romaine, confronte l’humain à une expérimentation, en confrontant son corps à un espace, à un territoire, à une échelle.
L’échelle des centuriation est immense, à l’image de l’empire qu’elle tente de recouvrir et c’est une tache faramineuse avec nos moyens d’étudiant en architecture. Cependant, si le carré n’est que « l’élément devenant le point de départ de la composition », alors ce n’est qu’une question d’échelle.
A une échelle différente, l’archéologique utilise le carroyage pour ces fouilles. Un article de FUTURA SCIENCE (https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/prehistoire-recherche-homme-neandertal-provence-661/page/4/) traitant d’une fouille du site pléistocène des Auzières, à Méthamis (Vaucluse), nous dit que « les informations sont d’ordre spatial : position des objets archéologiques, des couches, des pierres, etc… Pour pouvoir enregistrer toutes ces informations spatiales en trois dimensions, il est indispensable de travailler dans un espace repéré et orienté. Pour cela, le volume du gisement est divisé en unités de fouille qui sont des parallélépipèdes rectangles verticaux de section carrée et que l’on appelle pour cette raison en une forme d’abus de langage « les carrés ». La taille des carrés dépend de la nature de la fouille« .
Ainsi le carroyage archéologique, dont « la taille des carrés dépend de la nature de la fouille » adapte l’élément en fonction de son site. Un changement d’échelle est opéré selon le site. Cette technique nous donne aussi une dimension supplémentaire : Le volume.
Selon Von Meiss dans son ouvrage De la forme au lieu, « le cube n’est qu’une extension du carré ». Ainsi cette nouvelle division quadratique de l’espace permet à l’humain non pas seulement de reposer sur un quadrillage plane en 2D mais de s’inclure dans un territoire qui prend du volume et propose des espaces.
L’expérimentation et la confrontation du corps à l’espace citée en début d’article est ainsi complétée par la notion de volume 3D.
Les trois articles « Protofigures dans l’Histoire » et « Centuriation romaine : une division géométrique du territoire » et « Carroyage : une histoire d’échelle ? » on permis de faire ressortir des termes clés : divisions, carré, cube, carroyage, espace, échelle, territoire, rapport au corps, expérimentation. Ces termes et ces inspirations sont le point de départ du projet ELEMENT.
Dans le prochain article, nous verrons le mise en oeuvre des inspirations et modes de pensées dans une réalité physique de projet.
Lucia Decalf, Lesoille Noé, Studio Fauvel